La célèbre actrice belge Alexandra Vandernoot, connue notamment pour son rôle dans Le dîner de cons, a récemment déclenché la polémique avec des propos critiques à l’égard du mouvement #MeToo. Lors d’une interview accordée à TV Magazine, elle s’est exprimée sur ce qu’elle perçoit comme les dérives d’un féminisme devenu, selon elle, trop radical. Un témoignage symptomatique d’une inquiétude croissante dans certains milieux culturels et médiatiques, souvent présentée sous forme de défense de la "liberté d'expression".
Un discours familier : “On ne peut plus rien dire”
Les critiques d’Alexandra Vandernoot s’inscrivent dans une rhétorique bien connue : celle de la nostalgie d’un humour jugé “plus libre”, et de la dénonciation d’un climat social devenu, selon certains, étouffant. En affirmant que “l’on ne peut plus faire de blagues de cul”, l’actrice rejoint une frange d’artistes et d’humoristes qui s’interrogent publiquement sur les conséquences de la parole féministe libérée depuis l’affaire Weinstein.
Cette idée selon laquelle #MeToo aurait “trop durci les règles” dans les rapports sociaux et artistiques revient régulièrement dans le débat public, notamment sur des chaînes comme CNews ou dans les colonnes du Figaro.
“Plus de blagues, plus de liberté” : humour sous tension
“On a mis le curseur à l’extrême depuis #MeToo”, affirme Vandernoot dans cette même interview. Elle déplore une forme d’autocensure généralisée qui pèserait sur le monde du spectacle. Si certains artistes — comme Laurent Baffie — reconnaissent une évolution des sensibilités, ils refusent pour autant de parler de “dictature” ou d’interdits réels. La frontière entre responsabilité et censure reste donc floue.
Le comique Patrick Sébastien, ou encore l’auteur Serge Lama, avaient tenu des propos similaires, insistant sur la “perte d’humour” dans la société. Pour d’autres, cette évolution est salutaire, car elle permet enfin de remettre en question des blagues sexistes ou stéréotypées longtemps tolérées sans débat.
Les hommes “apeurés” ? Une crainte exprimée par Vandernoot
Au-delà de la question humoristique, Alexandra Vandernoot pointe ce qu’elle considère comme une détérioration des relations hommes-femmes. Elle cite notamment un exemple emblématique : aux États-Unis, certains hommes refuseraient désormais de prendre l’ascenseur avec des femmes, de peur d’être accusés à tort de harcèlement ou d’agression sexuelle.
Ce discours, relayé depuis plusieurs années par certains médias conservateurs, repose sur une perception anxiogène du féminisme, vu comme un risque pour la spontanéité ou la convivialité des relations sociales.
| Thème abordé | Position d'Alexandra Vandernoot |
|---|---|
| Liberté d'expression | Menacée par les excès du féminisme selon elle |
| Humour | Jugé restreint depuis #MeToo |
| Rapports sociaux | Relations hommes-femmes devenues tendues et méfiantes |
Un “climat de peur” : retour au puritanisme ?
Dans son analyse, l’actrice belge évoque un retour à une forme de “puritanisme” : un climat où tout comportement, toute parole, serait potentiellement répréhensible. Elle parle d’“une zone de flou, de pudibonderie”, où règne selon elle une peur d’être mal compris ou accusé injustement.
Ce sentiment rejoint les observations faites par des chercheurs et journalistes, notamment la féministe Rose Lamy, autrice du compte Préparez-vous pour la bagarre, qui déconstruit régulièrement ce type de discours. Selon elle, ce genre de prise de position relève d’un mécanisme de défense visant à préserver des privilèges anciens, aujourd’hui remis en cause.
Le paradoxe des opposants : MeToo “nécessaire mais…”
Dans la même interview, Alexandra Vandernoot précise qu’elle reconnaît l’utilité de #MeToo. Elle affirme : “Je pense que MeToo est nécessaire, mais j’espère qu’on ne va pas rester là-dedans.” Cette formulation ambivalente — qui commence par valider le mouvement avant de le nuancer fortement — est fréquente chez les détracteurs modérés du féminisme contemporain.
Elle renvoie à un paradoxe fondamental : vouloir le changement sans les conflits, la remise en cause sans le dérangement. Or, pour les militantes féministes, le caractère disruptif de #MeToo est précisément ce qui lui donne sa force.
Réactions croisées : de Florence Foresti à Rose Lamy
Le discours tenu par Alexandra Vandernoot s’inscrit dans un courant partagé par plusieurs figures publiques. L’humoriste Florence Foresti, elle-même féministe assumée, a parfois exprimé des points de vue proches, en appelant à ne pas généraliser ni tomber dans l’hostilité systématique envers les hommes. On y retrouve le fameux “not all men”, slogan parfois jugé contre-productif par les militantes de terrain.
À l’inverse, des voix comme celle de Rose Lamy rappellent que le mouvement MeToo n’est pas une chasse aux sorcières, mais une invitation à reconsidérer des comportements longtemps banalisés. Pour elles, il ne s’agit pas d’opposer hommes et femmes, mais d’instaurer des rapports plus égalitaires et respectueux.
Quand la nostalgie masque le rejet du progrès
La plainte de Vandernoot sur l’humour, le flirt ou les interactions sociales “bridées” s’inscrit dans une nostalgie plus large : celle d’un passé où l’homme pouvait plaisanter sans se soucier des conséquences. Or, ce “bon vieux temps” n’était souvent plaisant que pour une partie de la population, généralement masculine et dominante.
Les résistances au changement social ne sont pas nouvelles. À chaque avancée féministe (droit de vote, droit à l’avortement, égalité salariale), une frange conservatrice oppose les mêmes arguments : déstabilisation de la société, danger pour les relations traditionnelles, perte de repères…
Entre dialogue et tensions, un débat à poursuivre
Les propos d’Alexandra Vandernoot révèlent la persistance d’un malaise face à l’évolution des normes sociales et culturelles. Si certains s’inquiètent d’un excès de censure ou d’une peur généralisée, d’autres soulignent au contraire que le mouvement #MeToo a permis une libération salutaire de la parole, en particulier pour les victimes de violences sexistes et sexuelles.
Au-delà des polémiques, le véritable enjeu semble être celui du dialogue : comment repenser l’humour, la séduction et la liberté d’expression à l’aune d’une société plus égalitaire ? Un débat complexe, où les raccourcis et les caricatures n’aident personne.
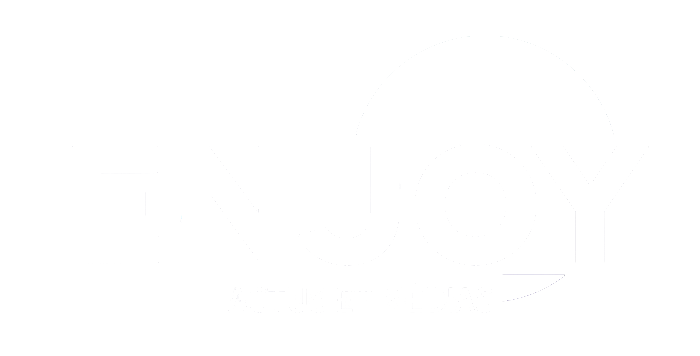





Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à commenter !